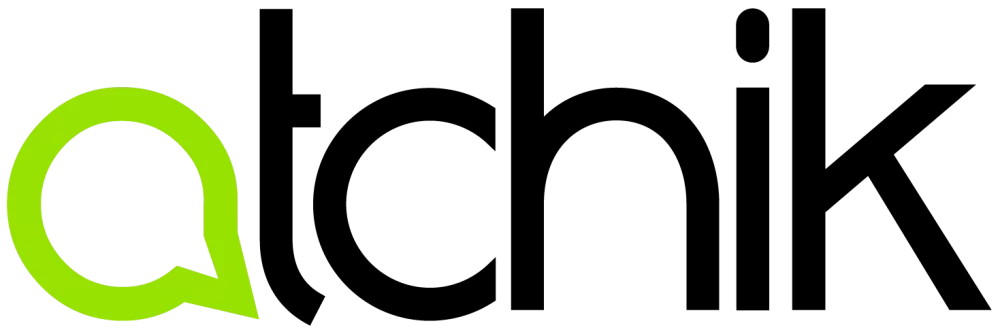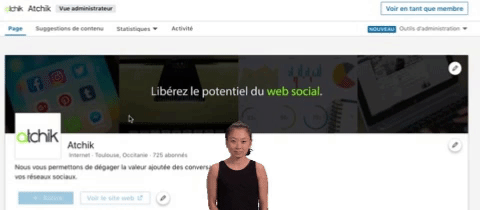En annonçant un déploiement en cours sur la modération des réponses à un tweet, le réseau social aux 240 caractères, défenseur historique de la liberté d’expression la plus poussée, fait non pas un mais deux grands pas en avant… Et engage de nombreux acteurs du web social sur son chemin. Explications de ce qui nous semble être une décision majeure et salutaire.

C’était il y a sept ans. En septembre 2012, contre vents et marées, Twitter maintenait son cap d’une liberté d’expression quasi-absolue et en faisait son étendard, dans un océan du web social en pleine concentration et dont les eaux les plus fréquentées se teintaient d’un profond bleu Facebook. Vente de données, rentabilisation des communautés, tels étaient les enjeux et les pressions devant lesquelles Twitter se refusait à tout abandonner, bien au contraire. Sa marque de fabrique et son modèle économique – sa monétisation qui a tant fait couler d’encre – devaient bientôt reposer sur cette ouverture, cette accessibilité et cette expression sans limites, pour le confort et la satisfaction de ses utilisateurs.
Oui mais voilà : les quelques années suivantes, les rumeurs et autres « fake news » ont pullulé, les dictionnaires Oxford ont fait de la « post-vérité » (post-truth) le mot de l’année 2016, les groupes politiques se sont organisés au point de démultiplier les zones de bombardement des éléments de langage et autres réponses aux accents pavloviens… Et même les vieux loups de mer du réseau bleu clair ont été tentés de changer de cap ou de déserter ses eaux, lassés par la stérilité croissante et, parfois, inexorable, des échanges. Et c’est dans cette nouvelle configuration, où l’expression désordonnée de tous génère du bruit pour tous, que Twitter monte au créneau.
Une expression faite de moins de bruit, plus de sens et autant de liberté ?
Voilà une équation délicate. C’est pourtant ce défi que Twitter se propose de relever avec sa fonctionnalité de masquage des tweets de réponse. En clair, lorsqu’un utilisateur tweete, des réponses peuvent s’agréger et générer un fil (thread) ; or ce fil peut être pris d’assaut par des utilisateurs vulgaires, critiques, polluants ou malveillants (si si, demandez à Samuel Laurent). 1% de trolls avérés et quelques messages d’interactions totalement dénuées d’intérêt doivent-ils pour autant gâcher toutes les conversations ?
La réponse formulée par Twitter, et à laquelle nous adhérons totalement en tant que modérateurs, est bien évidemment non. En permettant à un auteur de masquer les réponses à son propre tweet, le réseau offre la possibilité de mettre de l’ordre dans les commentaires… Sans pour autant censurer : en effet, les tweets masqués seront toujours accessibles à ceux qui voudraient les consulter. Mieux : ils prendront pour certains un peu de valeur en montrant le type de réponses écartées, en toute transparence.
@Twitter Thanks for the new feature I was notified of tooday! The new feature that lets the tweet autor "hide" replies to his tweet. Now we can go directly to what the author doesn't want us to see, and read all the censored stuff first.
— Not your Mom (@Notyour28981739) October 10, 2019
Twitter et le pari de l’éditorialisation
Qu’est-ce qui fait de Twitter un endroit si particulier ? Son expression, sa rapidité, ses messages, ses répliques cultes… Bref, son contenu. Et pour garder son intérêt, le réseau sait bien qu’il doit remettre en avant ses talents et permettre de les pousser prioritairement : ce fut le choix d’introduire un algorithme de sélection en plus du simple classement chronologique, par exemple ; c’est aujourd’hui le choix de rendre à un auteur le contrôle de ses fils de discussion et, ainsi, de rendre plus apparents ses choix et sa couleur éditoriale. Non qu’il s’agisse d’une obligation à prendre parti mais plutôt, a minima, à faire place nette et juger de la valeur, pour les lecteurs, de toutes les réponses sur des questions de forme et, pourquoi pas, de fond. Le choix des critères de chacun sur Twitter s’avère d’ores et déjà passionnant !
This new Twitter feature that lets tweet authors hide replies to their tweets is...I don't see how this could be abused by anyone in any way 🙄
— 🇺🇸Josh Keaton🇵🇪 (@joshkeaton) October 10, 2019
La reconnaissance ultime de la modération
C’est là le deuxième pas fait par Twitter… Et peut-être le plus décisif. En introduisant ainsi la modération dans son dispositif sans céder un pouce à ses convictions de liberté d’expression, la firme à l’oiseau bleu officialise l’importance capitale des modérateurs dans la vie des réseaux sociaux et des espaces d’expression en ligne. Sans possibilité d’y voir une quelconque censure, laquelle serait rendue impossible par l’effet Streisand généré par les éventuels masquages abusifs, dans la mesure où les tweets écartés restent à tout moment consultables.
Pourra-t-on alors sérieusement y voir une atteinte à la liberté d’expression ? Non. Comme détaillé ci-dessus, seule la liberté de troller s’en trouvera affaiblie. Censure ? Pas vraiment : rien n’empêche de se plaindre d’un masquage et, d’ailleurs, il y a fort à parier que les interactions mécaniques de type « visiblement, mes propos dérangent / font mouche / disent la vérité (sélectionnez votre variante préférée), j’ai encore été censuré » ne tarderont pas à éclore. S'il est certain que de nombreuses marques et entreprises seront tentées de cacher les critiques, le fameux effet Streisand discuté plus haut ne tardera toutefois pas à dissuader les responsables de ces comptes.
hide reply is the best feature of twitter in years: it makes you the editor of your tweet’s timeline.
— santi 👹 (@santisiri) October 10, 2019
Le choix des messages masqués en dira ainsi long sur le type de profil administrateur de ces échanges et sur l’intérêt des conversations qu’il génère et entretient, sur le long terme.
Les médias, les personnalités publiques et les grandes marques auraient donc tout intérêt, dès lors, à prendre très au sérieux cette fonctionnalité à venir et à investir dans une modération intelligente, pondérée et… Valorisante. Car plus leurs comptes seront entretenus, plus leur intérêt pour leurs communautés éclatera au grand jour !
Ca y est : après des mois de tests, Twitter lance sa fonction de masquage des réponses dans le fil d'un tweet par son auteur. On en sait désormais un peu plus sur le déploiement mais aussi sur la portée, l'ergonomie et les possibles applications de la fonctionnalité de modération dont on vous parlait en mars. Et franchement, il semblerait que Twitter ait vraiment cherché à faire les choses bien... Pas étonnant car sur ces questions, le réseau est attendu au tournant. Comment appréhender ce qui s'apparente à une révolution majeure sur les réseaux sociaux ?

Depuis son origine, Twitter se pose en garant de la liberté d'expression la plus totale, flirtant parfois avec l'illégalité selon les pays ; en France, par exemple, le négationnisme est répréhensible dans le cadre de la loi Gayssot. Malgré ces impératifs juridiques imposés par certains états, Twitter a toujours revendiqué la liberté d'expression et n'a cédé pour la première fois qu'en 2012, pour fermer des comptes néo-nazis jugés illégaux en Allemagne.
Et si les systèmes de modération ont largement fait florès du côté de Facebook, Youtube, Twitter ou Instagram, permettant au propriétaire d'un compte de supprimer ou masquer des contenus inappropriés, Twitter avait jusqu'ici limité l'intervention aux signalements de comptes, c'est-à-dire que le réseau social seul gardait la main sur les contenus visibles ou non. Aujourd'hui, c'est donc une petite révolution que connaît l'Oiseau Bleu en donnant la possibilité de masquer les réponses à un tweet... Mais Twitter a-t-il pour autant renié sa philosophie ?
Du terrain en friches au paysagisme
Visiblement, tout a été pensé pour ne jamais risquer de tomber dans la censure car, chose assez inédite dans le monde des réseaux sociaux, les messages masqués resteront tout de même accessibles ! Il suffira pour cela de cliquer sur "afficher les messages masqués" pour en prendre connaissance. Mais alors, quel intérêt ? Si ce n'est pas évident à première vue, nous voyons déjà trois conséquences nettement positives :
- Donner de l'intérêt aux messages masqués, c'est-à-dire du relief aux discussions en affichant des choix éditoriaux. Si par exemple une personnalité politique décide d'exclure des réponses pour la simple raison qu'elles ne lui conviennent pas, cela en dira long sur sa capacité à dialoguer et se remettre en question ;
- Donner plus d'intérêt à certaines discussions : si la modération opérée est de qualité, les Twittos verront vite que les critères de masquage retenus sont vérifiables objectivement (insultes, diffamation, vulgarité, spam...). Cela rendra toute sa valeur à la conversation et attirera les profils les plus pertinents ;
- Eviter la victimisation classique des trolls : "la vérité dérange, j'ai encore été censuré". Ici, le contenu sera toujours vérifiable.
De la modération en transparence ?
En isolant ainsi les commentaires problématiques et en laissant à chacun le soin de signaler les contenus illicites, Twitter semble composer entre l'impératif de nettoyage - demandez à Samuel Laurent - pour garder des conversations utiles et agréables et la nécessité de laisser l'expression la plus libre possible. Cela change complètement l'éditorialisation des tweets et, de fait, ouvre de nouvelles perspectives.
Et en veille, quelles conséquences ?
Si l'impact sur les discussions peut s'imaginer aisément, celui sur la veille est plus délicat car techniquement, il n'est pas dit que tous les outils récupèrent ces nouveaux types d'éléments. Ainsi Visibrain, Talkwalker ou Sysomos afficheront-ils ces messages dans leurs résultats de recherche ? Si oui, sous quelle forme ? Un libellé particulier serait une idée intéressante pour juger de la portée d'un contenu masqué ou de la décision sous-jacente à son exclusion par exemple.
Reste, enfin, la question du confort pour les utilisateurs et de l'intérêt à long terme de cette option : est-ce que l'introduction de cette fonctionnalité rendra Twitter moins captivant, à l'image de l'algorithme qui ne permet plus de voir tous les tweets par défaut ? Nous ne le pensons pas car, ici, la plateforme laisse clairement le choix de tout voir ou non. Une ergonomie au service du sens mais aussi du débat et, plus largement, de la valeur de tous ces échanges en ligne !
Nous suivons l'évolution de près : n'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn pour ne rien rater.
Vous avez reçu un nombre incalculable d'invitations pour suivre des pages d'entreprise sur LinkedIn ? Ne vous en faites pas, cette fonctionnalité a désormais été mise hors service par la plateforme ! On vous explique pourquoi.
Dites adieu aux invitations de pages sur LinkedIn :
Depuis peu, il n'est désormais plus possible d'envoyer des invitations à ses relations pour suivre sa page d'entreprise. Anciennement, vous pouviez envoyer un nombre sans limites d'invitations individuelles à tout votre réseau pour inviter vos relations à suivre votre page d'entreprise. Nous vous l'avions expliqué dans ce précédent article. Cette fonctionnalité était en effet intéressante pour donner un petit coup de pouce au nombre d'abonnés de votre page, et par conséquent à la notoriété de votre entreprise.
Mais aujourd'hui, l'option a bien été mise hors service. Nous avons contacté LinkedIn, qui nous a confirmé qu'elle a été temporairement désactivée.

"Bonjour Valentin, merci de nous avoir contactés. Nous cherchons constamment à aider nos membres et les entreprises à communiquer entre eux. Dans cette optique, nous avons lancé un test avec cette nouvelle option appelée "Inviter à suivre", et nous avons découvert que certains de nos membres n'étaient pas satisfaits de cette fonctionnalité. Nous avons temporairement désactivé cette option et nous la remettrons en ligne dès lors que nous l'aurons améliorée. Merci pour votre compréhension et nous vous souhaitons une bonne journée, MH."
Une option tombée dans le piège du spamming :
On l'a beaucoup remarqué, sur Twitter notamment, beaucoup d'internautes se sont plaints de l'apparition de cette nouvelle possibilité de développement, regrettant le nombre d'invitations reçues par jour. En effet, la comparaison avec le "spam" était très proche de la réalité.
Je ne sais pas ce que Linkedin a en tête avec les invitations entreprises, mais pour l’instant, ça ressemble à du spam ....😖
— Christian Renard (@christianrenard) June 18, 2019
Retour au growth hacking authentique :
Ce levier permettait de donner plus de visibilité à une page en grossissant l'audience par le biais de ces invitations. Ne coûtant littéralement rien à une entreprise, cette technique marketing rentrait dans les grandes lignes du growth hacking. Mais il va falloir revenir en arrière et repenser sa stratégie social media. Si vous ne savez pas quelles ficelles tirer pour rendre votre page plus visible sur LinkedIn, pensez à la prospection sociale, un puissant levier de visibilité et de développement !
Depuis quelques temps, il est possible d'inviter son réseau à aimer sa page d'entreprise sur LinkedIn en envoyant des invitations individuelles à son réseau. Pourquoi est-ce une fonctionnalité intéressante à l'heure de l'innovation dans la publicité en ligne ?
(Dernière édition le 10/09/2021)
Élargir son audience LinkedIn :
Le premier but de cette nouvelle fonctionnalité est avant tout de pouvoir élargir l'audience de votre page. Grâce à ces invitations, un large panel d'invitations s'offre à vous : vos clients, vos prospects, ou même vos anciens camarades de classe peuvent être invités à aimer la page de votre entreprise. C'est un moyen simple, efficace, et non-invasif pour grossir votre communauté. Sans compter que vous ne faites pas appel à la publicité, et que vous envoyez des invitations "ciblées".
Développer la notoriété de votre entreprise :
Inviter son réseau à suivre sa page d'entreprise sur LinkedIn permet de donner un coup de pouce à la notoriété et à la visibilité à son entreprise. Cela facilitera aussi le bouche-à-oreille, qui reste une technique marketing authentique et qui ne vous coûte rien. Attention cependant à ne pas inviter n'importe qui ! Il est préférable d'inviter des personnes ciblées, qui seraient intéressées par le contenu que vous postez et qui interagiront avec. Envoyer des invitations seulement pour grossir le nombre d'abonnés sur votre page n'apportera rien sur le long terme, et ne la rendra pas "authentique".
Pour aller plus loin : Veille sur LinkedIn, quelles solutions ?
Comment inviter son réseau à aimer sa page LinkedIn :
Pour finir, il suffit de suivre les étapes suivantes :
- Connectez-vous à un compte administrateur de votre page d'entreprise LinkedIn.
- Une fois que vous vous trouvez sur la "vue administrateur", cliquez sur "Outils d'administration" sous le bouton "Voir en tant que membre".
- Un menu déroulant s'affiche, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur "Inviter des relations".
Et voilà ! Vous avez envoyé les invitations à votre réseau pour aimer votre page d'entreprise.
Depuis mai 2020, LinkedIn attribue 100 crédits d'invitations par mois par page. Si vous envoyez une invitation, vous utilisez donc un crédit... Mais vous le récupérez instantanément si la personne que vous avez invitée accepte votre invitation ! Le réseau social rappelle cependant qu'il n'est pas possible de dépasser la limite quotidienne, et que les crédits non-utilisés ne peuvent pas être cumulés avec ceux du mois suivant.
En parlant de ça, nous sommes aussi sur LinkedIn ! N'hésitez pas à nous suivre pour être tenus informés des actualités du secteur digital, des réseaux sociaux, et de la veille en cliquant ici 😉
Rentable, dynamique et porté vers l'avenir : c'est l'image de ce début 2019 affichée par le New York Times, qui vient d'annoncer 127 millions de dollars de bénéfice. (suite…)
Les community managers le savent bien : gérer un ou plusieurs comptes sur les réseaux sociaux nécessite du temps et une certaine assiduité.
Heureusement, il existe des outils qui permettent d'optimiser sa présence en ligne. Mais, ces derniers étant nombreux sur le marché, on a souvent du mal à faire le tri. Alors, lequel choisir ? Il n’est pas si facile de trouver un outil proposant des métriques fiables, une ergonomie et un aspect pratique qui le rendent accessible, une bonne couverture des plateformes existantes... Et tout ça à un prix abordable !
Nous on a choisi Nonli, un outil made in Marseille, et on vous explique pourquoi.

Nonli, qu’est-ce que c’est ?
Particulièrement orienté éditeurs, l’outil permet de publier du contenu, aussi bien déjà existant que créatif, sur les différents réseaux sociaux reliés (Facebook, Twitter et LinkedIn à ce jour). Chez Atchik on utilise essentiellement cet outil pour mettre en ligne les articles de nos clients sur leurs différents réseaux sociaux, et, sincèrement, on aurait aujourd’hui du mal à s’en passer.
Premier point fort : sa facilité d’utilisation. Très instinctif, il permettra aux personnes les moins à l’aise de l’apprivoiser rapidement et donc de gagner énormément de temps. D’autant plus qu’il est également possible de publier le même contenu sur différents espaces simultanément. Plus besoin de jongler entre différents outils, et ça, c’est quand même bien pratique.
Dans le cas de la presse, les contenus rédigés par les journalistes, dédiés aux sites web voire à la version print, ne sont pas toujours adaptés à une diffusion sur les réseaux sociaux. Or, on le sait, l’important pour un community manager média, c’est le clic ! Seulement, l’aperçu d’un article généré automatiquement aura souvent tendance à trop en dire. Grâce à Nonli, on pourra modifier le titre et supprimer le chapô pour inciter les lecteurs à vouloir en savoir plus… sans faire de putaclic (ou « clickbait »), évidemment 😉
Engagement, quand tu nous tiens
Etre présent sur les réseaux sociaux, c’est bien, mais fidéliser une communauté et impliquer les internautes, c’est mieux ! Publications organiques ou sponsorisées, tous les moyens sont bons pour optimiser sa présence en ligne, à condition de savoir ensuite analyser ses performances. Plusieurs variables peuvent être ajustées en conséquence : l’heure de publication, le sujet, la forme… il est important de « tester » sa communauté afin de la connaitre sur le bout des doigts et, de fait, communiquer efficacement.
Grâce à son tracker intégré, Nonli permet d’accéder en un seul coup d’œil au nombre total de clics, aux détails sur leur origine (Facebook, Twitter, desktop, mobile, tablette) et à la performance en temps réel des publications, avec des statistiques plus fidèles et lisibles que les plateformes sociales qui sont souvent quelque peu mystérieuses.
Autre atout, il est possible d’organiser ses dashboards par marque, un gros plus pour les CM devant gérer les réseaux sociaux de multiples clients. Cela évitera certaines maladresses de publication (allez, on sait que ça vous est déjà arrivé !).
Et les concurrents, dans tout ça ?
Pour une stratégie social media efficace, il faut évidemment connaitre sa communauté (on ne le répètera jamais assez) mais également celles de ses concurrents ! Si l’idée n’est pas de les imiter, il va de soi que connaitre le secteur dans lequel on évolue est indispensable pour affiner sa propre stratégie. Pour cela, Nonli propose, par exemple, de déterminer quels articles obtiennent les meilleurs résultats à un instant T parmi les organes de presse proches des nôtres : un bon indice pour adapter son propre contenu !
Vous l’aurez compris, on est assez admiratifs quant aux vastes options qu’offre Nonli à ses utilisateurs ! Seul petit bémol cependant, Instagram n’est pour l’instant pas proposé (comme la grande majorité des outils sur le marché, on vous le concède). Mais attention, on a entendu dire que des changements étaient en préparation, alors wait and see !
Barbara